Les plus anciennes formes vivantes sont apparues il y a 3,8 milliards d’années: en matière de durabilité, la nature a une certaine d’avance sur les sociétés humaines… Chaque espèce doit sa survie à un processus d’adaptation naturelle, faite d’essais et d’erreurs, chargée d’enseignements et d’un savoir-faire de génie dont il serait dommage de ne pas s’inspirer: tel est le point de départ du biomimétisme. Ce qui pourrait sembler une simple lubie est au cœur de technologies de pointe, dans l’aéronautique ou la médecine.
Cette approche a été définie en 1997 par la biologiste américaine Janine M. Benyus dans son ouvrage Biomimicry (1), sous-titré Innovation Inspired by Nature.
Ce livre pionnier, rapidement popularisé aux Etats-Unis, n’a été traduit en France qu’en 2011, sous le titre Biomimétisme, quand la nature inspire des innovations durables. Avant cela, la théorie a fait quelques émules en Europe, au point de donner à naissance en 2006 à Biomimicry Europa (2). Le comité, composé de biologistes, d’architectes, de professionnels du monde de l’entreprise et des collectivités territoriales, tente, depuis Bruxelles, de faire partager sa conviction à long terme : « La réussite du vivant en matière de durabilité doit permettre de trouver des solutions pour une économie résiliente aux changements climatiques, qui fixe du carbone et qui soit en totale harmonie avec la biosphère, afin de garantir une justice sociale et un bien-être durable capable de préserver les capacités des générations futures à satisfaire leurs besoins. »
Les conditions du vivant
Gauthier Chapelle est l’un des principaux fondateurs de Biomimicry Europa. Ce biologiste belge, de conférences en interviews, pointe les limites de notre développement actuel, tout en reprenant le constat de départ de Janine Benyus : tous les objets humains, même issus des usines chimiques et des centrales nucléaires, sont naturels, au sens où ils sont produits par des êtres de nature. En revanche, ces objets ne sont pas encore ajustés au vivant, et l’évolution va, comme elle l’a toujours fait, filtrer ce qui n’est pas compatible avec la nature.
Pour anticiper cette élimination, les tenants du biomimétisme ne se réfèrent qu’à un seul expert : la nature elle-même, la seule entité terrestre capable de maîtriser sa propre durabilité. Ignorance totale de la stabilité, conscience de la finitude du système terrestre, indissociabilité entre la vie et l’eau, reconnaissance de l’énergie solaire comme source principale de l’énergie disponible sur la Terre : voilà quelques-unes des conditions du vivant, pourtant unanimement maîtrisées, mais que Chapelle aime à rappeler. La naissance du biomimétisme est aussi tardive que son inspiratrice est ancienne.
Comment se définit le biomimétisme ? Il faut déjà le détacher de son étymologie trompeuse, qui laisserait entendre qu’il s’agit de copier tout bonnement la nature. Le biomorphisme (3) s’en charge déjà: placé dans le champ de l’esthétique, il a recours à des formes issues de la nature, choisies et simplifiées pour des raisons structurelles et plastiques. Le but du biomimétisme n’est pas non plus d’aller du côté de l’innovation technologique, ce à quoi se dédie cette fois la bionique. Cette dernière s’appuie sur l’observation du fonctionnement des organismes vivants pour les transposer aux créations humaines, de la robotique à l’aéronautique en passant par l’intelligence artificielle. Ni esthétique, ni technologique, le biomimétisme s’inscrit dans une démarche d’innovation durable. Selon la définition de Janine Benyus, il « fait appel au transfert et à l’adaptation des principes et des stratégies élaborés par les organismes vivants et les écosystèmes, afin de produire des biens et des services de manière plus durable, et, finalement, de rendre les sociétés humaines compatibles avec la biosphère ».
En s’inscrivant ainsi dans la durée, le biomimétisme repose sur nouvelle estimation de la valeur nature, ou plus précisément il renoue avec une estimation préindustrielle de la nature. Congédiant l’idée d’une nature nourricière au service de l’avancée humaine et technique, le biomimétisme veut penser nos sciences et notre intelligence actuelles comme capables d’adapter les solutions de la nature à notre propre contingence.
Une vision préindustrielle ?
On peut considérer qu’il s’agit là de renouer avec une vision préindustrielle. Mais c’est aussi reconnaître que nos ancêtres ont pratiqué le biomimétisme pendant des millénaires. Des colonnes des temples égyptiens modélisées plus ou moins consciemment sur la forme des palmiers, aux igloos inuits inspirés des tanières d’ours blancs, l’histoire humaine ne manque pas d’exemples. Mais cette imitation instinctive n’implique pas forcément de connaissance profonde et rationnelle du vivant. En cela, Leonard de Vinci, au XVIe siècle, est souvent cité comme l’un des plus grands observateurs de la nature, et notamment des techniques de vol, de décollage et d’atterrissage des oiseaux. Après avoir longuement observé l’anatomie des oiseaux et la position des plumes puis mis en évidence le rôle essentiel du centre de gravité, il réalise en 1488 les premiers dessins d’un célèbre « ornithoptère », une machine volante qui, du reste, ne s’élèvera jamais. De Vinci ne sera pas le seul à buter sur la prouesse jusqu’ici inégalée des volatiles. Quelques siècles plus tard, Etienne Oehmichen (1884-1955) consacrera sa vie à percer le mystère du vol des insectes. Aujourd’hui, les spécialistes reconnaissent son génie, notamment dans un domaine de pointe, précisait récemment un article du Monde (4) : il s’agit les microdrones à ailes battantes, des objets volants nés de l’observation du vivant. L’un des plus aboutis technologiquement est l’hummingbird“>oiseau-mouche, présenté en 2011 par la société américaine AeroVironment et élu comme l’une des meilleures inventions de l’année par le Time.
Aujourd’hui, il est vrai que la nature demeure une source d’inspiration inépuisable chez les avionneurs. Dans une interview donnée à L’Usine nouvelle, Denis Darracq, chef de la recherche et technologie physique de vol chez Airbus, montre que la nature peut être imitée à différentes échelles. Les exemples qu’il livre coïncident en fait avec les différents niveaux possibles de biomimétisme, tels qu’ils ont été théorisés par Janine Benyus.
Le premier niveau se limite à l’imitation stricte de la forme. Denis Darracq cite les ailettes quasi verticales en extrémité de voilure, qui améliorent l’efficacité du vol pour une envergure donnée. Ces ailettes sont directement inspirées de la forme des ailes de l’aigle des steppes. Elles permettent de rendre la taille de l’A380 compatible avec les standards aéroportuaires, tout en garantissant d’excellentes performances aérodynamiques.
Le second niveau de biomimétisme dépasse l’imitation purement formelle pour se concentrer sur la fabrication, la stratégie du vivant. À cette échelle, les concepteurs d’avions se sont par exemple inspirés de la fonction de détection des rafales par le bec de certains oiseaux de mer. Encore plus appréciée des biomiméticiens, une imitation de second niveau couplée d’un souci de durabilité ! La peau des requins est recouverte de rainures microscopiques réduisant le frottement de l’écoulement sur l’animal, et améliorant ainsi son efficacité énergétique et sa vitesse. Les essais ont confirmé que ce type de surface réduit bien les frottements aérodynamiques, ce qui permet de réduire la consommation et les émissions de CO2.
L’échelle des écosystèmes
Le niveau biomimétique ultime est atteint lorsque l’imitation se place à l’échelle d’écosystèmes entiers. Cette fois-ci, le but est de reproduire un ensemble d’interrelations tel qu’on en trouve au sein d’un écosystème « mature », comme les forêts tropicales ou les vieilles forêts tempérées. On les oppose aux écosystèmes « pionniers », ceux qui s’installent après une éruption volcanique ou un incendie, et donnent naissance à des espèces peu nombreuses, très spécialisées, et surtout très gourmandes en ressources. Les systèmes matures, eux, obéissent à ce que Janine Benyus nomme les « principes du vivant » : utiliser les déchets comme ressources, diversifier et coopérer, optimiser plutôt que maximiser, réduire l’utilisation des matériaux à son strict besoin, ne pas souiller son propre nid, etc. Si l’on ne trouve pas ce niveau de biomimétisme dans l’aéronautique, quelques ébauches jaillissent dans d’autres champs d’activités. Des chercheurs du monde entier se penchent activement sur la production d’hydrogène ou le procédé de la photosynthèse, principale source d’énergie de l’humanité.
Comme le note Gauthier Chapelle, il est utile de repérer également ce que la nature ne fait pas, ou encore les stratégies alternatives qu’elle peut mettre en œuvre. Un exemple connu, en lien évident avec son principe de diversité énoncé plus haut : les végétaux, pour se protéger des insectes, ont recours à une toute panoplie de stratégies. Au lieu que les solutions développées jusqu’à présent par l’homme, insecticides ou OGM, sont en fin de compte peu imaginatives, et de surcroît très rares dans la nature.
Mais une approche rigoureuse oblige en même temps à admettre que le transfert de gènes pratiqué dans le développement des OGM n’est pas inconnu de la nature. Certaines mutations génétiques spontanées, certaines erreurs lors des méioses (5) comportent des transferts de gènes et c’est l’un des facteurs qui permet l’évolution.
Il existe d’autres types d’enseignements, moins rebattus et pourtant très remarquables. Lors d’une intervention devant les étudiants de HEC en 2010, Chapelle fait remarquer que, contrairement à l’idée largement répandue selon laquelle l’innovation est fille de la compétition, les grandes innovations du vivant sont toujours nées de la coopération. Pour illustrer son propos, il se réfère aux champignons qui, dans un rapport de coexistence, permettent aux arbres d’être plus efficaces : « On dit souvent que pour atteindre un niveau de lumière suffisant, il existe un rapport de compétition entre les arbres, mais c’est faux. Le plus souvent, les grands arbres produisent des sucres en excès qu’ils transfèrent, via les champignons saprophytes (6), envers les jeunes arbres. C’est une relation de solidarité intergénérationnelle ». D’une certaine façon, les modèles de l’économie classique se rapprochent des premières formes, assez primitives, de la théorie de l’évolution : compétition, struggle for life, sélection. Mais cette théorie a évolué, et la science économique pourrait elle aussi raffiner ses modèles. La notion d’écosystème a d’ailleurs récemment fait son entrée dans le champ de l’économie industrielle.
Des trois échelles possibles de leur discipline (forme, stratégie, écosystèmes), les biomiméticiens considèrent la dernière comme la plus prometteuse. Selon elle, les innovations tirées du vivant visent à garantir la survie de l’espèce humaine. Cette finalité contraste bien évidemment avec certaines innovations biomimétiques souvent citées comme plus accessoires. Des maillots de bains inspirés de la peau des requins à la bande Velcro issue des crochets du fruit de la bardane, il est des progrès qui ne modifient pas le bilan carbone de l’humanité… En revanche, une agriculture auto-régénératrice imitant la nature changerait largement le visage de la planète.
En attendant l’avènement du modèle en boucle fermée, le biomimétisme est déjà là, sous forme d’applications concrètes ou de potentialités industrielles.
Potentialités industrielles
L’art du déplacement, tout d’abord, regorge d’exemples. Le plus célèbre est sans doute le train japonais à grande vitesse Shinkansen, dont le « nez » est dessiné selon la structure des martins-pêcheurs. Leur organisme est une solution optimale au changement de pression entre l’air libre et l’eau. La ligne du Shinkansen, parsemée de tunnels, causait des désagréments répétés aux voyageurs et aux riverains (onde de choc). Egalement passionné d’ornithologie, l’ingénieur Eiji Nakatsu, œuvrant sur la ligne Tokyo-Hakata, a conçu le nez du train selon la forme du bec (7) de l’oiseau plongeur. Cette imitation a permis une réduction du bruit et de la consommation électrique, mais aussi un gain de vitesse de 10%.
A l’opposé de la vitesse, le magazine Science et Avenir témoignait récemment d’une observation par des chercheurs espagnols et américains du mécanisme de propulsion (8) de l’escargot. Dans une perspective 100% biomimétique, cette observation servirait par la suite au champ médical, en permettant de déplacer un endoscope à l’intérieur de l’organisme, en profitant du mucus qui recouvre la trachée, l’œsophage ou le colon.
Hormis le champ du déplacement, le biomimétisme tient une place toute particulière dans le domaine de l’architecture et du bâtiment. Dans le droit chemin du biomimétisme de second niveau, c’est-à-dire imitant les procédés et non pas seulement les formes du vivant, l’immeuble Eastgate (9), à Harare au Zimbabwe, est conçu à partir du système de ventilation des termites africains. Les parties émergées des termitières sont des monticules pouvant atteindre 6 m, et dont le sommet chauffe au soleil. L’air monte dans le réseau de galeries et de cheminées. Cela provoque une aspiration par les côtés et un refroidissement de l’air forcé à redescendre. De leur côté, les termites régulent leurs ouvertures. Ouvertes par grande chaleur, elles ferment quand vient la nuit. C’est sur ce principe de ventilation naturelle que l’architecte américain Mike Pearce a réalisé son immeuble, qui réalise aujourd’hui des économies d’énergie de 90%.
Enfin, le biomimétisme fournit au secteur des matériaux, pour l’instant massivement issus de la pétrochimie, d’importants potentiels industriels. On apprenait récemment que des chercheurs chinois de l’université de Jilin avaient étudié la surface de la carapace du scorpion (10), en concluant que ses microstructures cannelées réduisaient les frottements par rapport à une surface plane, ceci expliquant en partie sa grande résistance aux vents de sable. Un modèle naturel pour les matériaux et les structures soumis à l’érosion.
Freins et obstacles
Ces différents exemples suggèrent le potentiel remarquable du biomimétisme, une approche qui peut contribuer à la durabilité de notre développement : optimisation des formes et des structures, analyse des organisations et des systèmes sociaux, optimisation cinématique, architecture… autant de domaines où les modèles issus du vivant peuvent avoir une réelle valeur ajoutée, voire autoriser des reconfigurations radicales.
Il est toutefois difficile de mesurer la valeur économique de cette approche, ou de spécifier ses marchés, et ce problème de représentation pourrait entraver son développement. A la différence des biotechnologies blanches, qui sont pour l’essentiel localisées dans le secteur de la chimie et dont on peut mesurer le chiffre d’affaires, le biomimétisme renvoie davantage à une approche globale, dans le travail de conception (architecture, ingénierie, recherche et développement) qu’à une section particulière, mesurable, d’un secteur d’activité.
Dans le même ordre d’idées, le manque de financements et l’incertitude du retour sur investissement jouent un grand rôle dans le maintien du biomimétisme au rang de concept émergent. Les incitations à changer d’approche sont peut-être encore trop faibles, comme le suggère Gauthier Chapelle : « Il est probable que l’énergie fossile ne soit pas encore assez chère et que tant que le processus de production industriel est encore rentable, rien n’incite à la rupture radicale. »
Une autre limite tient à la séparation académique entre les sciences du vivant et l’ingénierie ainsi qu’à une difficulté à raisonner de façon systémique. Or le biomimétisme est, en soi, fondé sur la pluridisciplinarité. Les domaines du spatial et du médical, en cherchant leurs complémentarités, ont pu augmenter leurs performances. En attendant, les formations d’ingénieur ou de concepteurs, jusqu’ici, incluent rarement des enseignements biologiques. Une formation à la biomimétique, déjà en chantier aux Etats-Unis, reposera nécessairement sur la pluridisciplinarité et le dialogue entre les cultures scientifiques. C’est un sujet à suivre de près.
[Article publié sous CC – ParisTech Review ]
Nota :

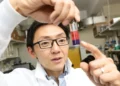







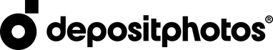


Le domaine est très bien présenté, tout à fait compréhensible pour un néophyte, et développe de manière intéressante les différents niveaux et composantes du biomimétisme. Encore une fois, on se rend compte que ce qui limite le développement et l’application de ce principe d’optimisation exceptionnel tient à peu de choses : nécessité de pluridisciplinarité impliquant la communication efficace entre des gens de formations et de convictions différentes ; paradigmes existants lancés tête baissée dans une course à la compétition et aveugle au changement ; risques liés à l’investissement en R&D indispensable à l’application à grande échelle de ces principes. Espérons que des articles comme celui-là insipireront des financement et des vocations propres à encourager les investisseurs, les chercheurs, les ingénieurs, les entrepreneurs, à faire preuve d’audace !