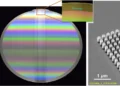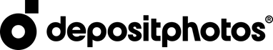Thomas Reverdy, Grenoble INP – UGA
L’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), particularité du marché français de l’électricité introduite en 2010 suite à l’intégration de la France aux marchés européens de l’énergie, doit prendre fin courant 2025. Retour sur l’histoire d’un dispositif controversé, mais trop souvent mal compris.
Le 31 décembre 2025, prendra fin une disposition spécifique au marché français de l’électricité, l’Accès régulé au nucléaire historique (ARENH). Cette disposition, mise en place en 2011, permettait aux fournisseurs concurrents de EDF d’accéder à un volume total d’électricité nucléaire de 100 TWh à un prix fixe de 42 euros par mégawatt-heure (MWh).
Régulièrement présentée par ses détracteurs soit comme une injonction autoritaire des autorités européennes, soit comme une spoliation d’EDF, les objectifs et les modalités de cette disposition sont souvent mal connus et incompris. Revenons sur l’histoire de ce dispositif.
Aux origines de l’ARENH
L’intégration de la France aux marchés de l’énergie européens après leur libéralisation a entraîné une hausse des prix à partir de 2004. Les clients industriels français se sont fortement mobilisés pour être protégés de cette hausse, suite à quoi l’État a mis en place un nouveau tarif réglementé pour les entreprises en 2006. La même logique a prévalu lors de l’ouverture des marchés pour les particuliers en 2007, l’État a décidé de maintenir, un tarif réglementé calculé sur la base des coûts de production.
Or, la hausse des prix sur les marchés de gros a produit un effet de « ciseau tarifaire ». Il empêchait les fournisseurs alternatifs, qui achetaient l’électricité sur le marché de gros, de se développer. En effet, ces derniers n’avaient pas la capacité de rivaliser avec le tarif réglementé et les offres de EDF, fondés sur les coûts plus compétitifs du nucléaire historique.
Ainsi, la volonté politique de protéger les entreprises et les consommateurs par le tarif a alors entraîné un blocage de l’ouverture à la concurrence. L’ARENH a été créé dans ce contexte : il permettait de respecter l’engagement européen de développer la concurrence, tout en permettant de restituer aux consommateurs français l’avantage économique du nucléaire historique.
Un mécanisme utile, mais progressivement fragilisé
Le choix du mécanisme a été motivé par un souci de continuité avec les équilibres économiques qui existaient avant la libéralisation. Il a effectivement permis aux consommateurs français de bénéficier de l’avantage économique du nucléaire existant, tout en leur évitant d’être exposés aux variations du prix de marché de gros européen, quels que soient l’offre tarifaire et le fournisseur. La distribution du volume ARENH aux fournisseurs alternatifs est très encadrée en amont et en aval, pour éviter qu’ils tirent un bénéfice immédiat en revendant l’électricité sur le marché de gros. Elle ouvre à des règlements financiers en cas d’écart avec les besoins du portefeuille de clients.
Néanmoins, le mécanisme a rencontré plusieurs configurations inattendues qui l’ont fragilisé. En 2015, le prix du marché de gros européen, en baisse, est passé en dessous du prix fixé pour l’ARENH. Dans cette situation, l’ARENH a perdu de son intérêt pour les fournisseurs alternatifs.
Cette alternative a révélé le caractère asymétrique du dispositif : il ne garantit pas la couverture des coûts d’EDF en cas de baisse des prix de marché en dessous du tarif de l’ARENH. En novembre 2016, des fluctuations des prix des contrats à terme, ont permis aux fournisseurs alternatifs de réaliser des arbitrages financiers impliquant l’ARENH.
Cette période de prix bas sur les marchés de gros a aussi permis aux fournisseurs alternatifs de développer leurs parts de marché, qu’ils ont conservées quand les prix ont remonté à partir de 2018.
En 2019, le volume de 100 TWh prévu par la loi ne permettait pas de couvrir tous les besoins en nucléaire des fournisseurs alternatifs (130 TWh). Un écrêtement de l’ARENH a alors été mis en place. Ce rationnement a eu pour effet de renchérir les coûts d’approvisionnement des fournisseurs alternatifs, dans la mesure où une partie de l’électricité d’origine nucléaire de EDF devait être achetée au prix du marché de gros pour compléter le volume d’ARENH manquant.
Ces derniers ont dû ajuster leurs contrats de fourniture en conséquence. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a augmenté en 2019 les tarifs réglementés de l’électricité pour refléter ces nouveaux coûts d’approvisionnement, pour que le tarif réglementé reste « contestable » (qu’il puisse être concurrencé) par les fournisseurs alternatifs. Un des effets de l’écrêtement est de revaloriser l’énergie nucléaire, dont une partie est désormais vendue par EDF au niveau du prix de marché, supérieur au tarif de l’ARENH.
Un avantage pour EDF face à la concurrence
La loi énergie-climat de 2019 prévoyait une augmentation du volume d’ARENH à 150 MWh de façon à mettre fin à l’écrêtement. En parallèle, il était envisagé d’augmenter son prix de façon à suivre la hausse des coûts du parc nucléaire. Le projet HERCULE de restructuration de l’entreprise, initié pour améliorer la valorisation financière de l’entreprise, était aussi une opportunité pour repenser le mécanisme ARENH et le rendre symétrique, garantissant à EDF un niveau de revenu minimal en cas de baisse des prix.
Or le projet HERCULE été abandonné face à la mobilisation syndicale car il portait atteinte à la cohérence de l’entreprise. Les modifications de l’ARENH ont été aussi abandonnées à cette occasion. Constatant que le prix de marché de gros suivait une tendance à la hausse, EDF avait plus à gagner à ce que l’ARENH ne soit pas modifié : elle pouvait gagner davantage grâce à l’écrêtement qu’avec une hypothétique réévaluation du prix de l’ARENH.
C’est donc avec un dispositif déséquilibré et asymétrique que le secteur électrique français a abordé la crise européenne de l’énergie en 2022. Du fait de la hausse des prix du gaz, une hausse des prix des contrats d’électricité à terme pour l’année 2022 a été observée dès le début de l’automne 2021.
Le gouvernement a alors décidé de mettre en place un bouclier tarifaire pour éviter que cette hausse n’affecte trop les consommateurs finaux – et éviter une crise politique dans un contexte préélectoral.
De la crise énergétique à l’« ARENH+ »
Pour réduire les surcoûts pour l’État et pour protéger les entreprises, il a aussi envisagé d’augmenter le volume d’ARENH pour répondre à une demande de 160 TWh. Réduire l’écrêtement de l’ARENH, permet de réduire l’achat d’électricité sur le marché de gros, ce qui réduit d’autant les factures de tous les clients, et donc le coût du bouclier tarifaire. Les négociations avec EDF ont retardé la décision.
Un « ARENH+ » a finalement été acté par le gouvernement en janvier 2022 pour la période de mars à décembre 2022. Au final, cette réduction d’écrêtement de l’ARENH a bien eu l’effet recherché par l’État, qui était de réduire le niveau des factures pour l’ensemble des consommateurs.
Néanmoins, compte tenu de son déploiement tardif, cette extension de l’ARENH à hauteur de 20 TWh supplémentaires a obligé EDF à racheter l’électricité nécessaire au prix de marché pour la revendre à un prix de 46 euros par MWh. Pour EDF, le coût direct était d’environ 4 milliards d’euros.
Un contexte critique pour le nucléaire d’EDF
Cette extension de l’ARENH est intervenue dans un contexte critique pour EDF. De nombreuses centrales nucléaires étaient indisponibles. La maintenance des centrales nucléaires a été retardée par la crise du Covid-19, la détection de problèmes inédits de corrosion sous contrainte ayant entraîné l’arrêt de nombreux réacteurs.
S’ajoute à cela la sécheresse des étés 2021 et 2022, qui a réduit les réserves d’eau dans les barrages et la production d’électricité d’origine hydroélectrique et nucléaire. Au cours de l’année 2022, EDF a dû importer de l’électricité aux pays européens voisins à des prix extrêmement élevés.
A l’automne 2022, le mécanisme de formation des prix sur le marché de gros européen s’est trouvé au cœur des débats en Europe et en France : il était question de limiter son influence sur la facture du consommateur. Paradoxalement, en France, le débat s’est alors focalisé sur l’ARENH. La commission d’enquête parlementaire « visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France » a alors été l’occasion, pour les anciens dirigeants d’EDF, de condamner l’ARENH, accusé d’avoir appauvri EDF et d’être responsable de la dépendance énergétique de la France.
L’extension de l’ARENH n’a pas été renouvelée pour 2023 et 2024, même si la demande d’ARENH est restée élevée, s’élevant alors à 148 TWh. De ce fait, les clients français ont acheté, directement ou indirectement, une large partie de l’électricité nucléaire de EDF au prix de marché de gros européen, exceptionnellement élevé. Ces deux années se sont donc avérées très profitables pour EDF, dont la disponibilité des centrales nucléaires s’est améliorée.
Un nouveau mécanisme qui expose davantage les acteurs aux aléas du prix de marché
Dans l’intervalle, le ministère de la transition a travaillé au remplacement de l’ARENH par un autre mécanisme symétrique. L’idée était de transposer au nucléaire historique les « contrats pour différence (CFD) symétriques », utilisés en Europe pour les énergies renouvelables.
Ce mécanisme devait permettre de garantir un complément de prix par rapport au marché de l’électricité, sécurisant ainsi la rémunération du producteur. Inversement, si le prix du marché augmente, l’État récupère l’écart, qu’il peut redistribuer aux consommateurs.
En parallèle, EDF a défendu un autre mécanisme, qui consistait à supprimer l’ARENH et à taxer les profits d’EDF quand ils dépassent un certain niveau. Bruno Le Maire a officialisé, en novembre 2023, l’arbitrage en faveur de ce second mécanisme, désormais validé dans le cadre de la Loi de Finance 2025.
L’électricité nucléaire sera donc vendue sur le marché et l’État pourra taxer EDF à hauteur de 50 % si les prix de marché dépassent un premier seuil calculé à partir des coûts complets de EDF – avec une marge non encore fixée – puis d’écrêter ses revenus en cas dépassement d’un second seuil. Les revenus issus de ce prélèvement devraient alors être redistribués de façon équitable entre les consommateurs.
Au-delà des incertitudes liées à la définition des seuils et des modalités de redistribution, le nouveau mécanisme valorise l’énergie nucléaire au prix de marché. EDF reste exposée au marché, mais conserve la possibilité de bénéficier des rentes générées par le nucléaire historique, pour financer ses investissements, en particulier dans le nucléaire futur. La préférence d’EDF pour ce second mécanisme tient aussi au fait qu’il permet d’accroître l’autonomie stratégique de l’entreprise tout en préservant sa cohésion organisationnelle.
Les clients industriels, les associations de consommateurs soulignent à l’inverse qu’il conforte l’entreprise dans sa position dominante et les prive d’une sécurité économique. Le mécanisme redistributif proposé risque d’introduire d’importantes inégalités dues à la diversité des formes d’approvisionnement. Ces consommateurs anticipent aussi des hausses des prix en janvier 2026, qui pourraient mettre en danger la dynamique d’électrification, clef de voûte de la décarbonation.
Ainsi, l’ARENH a joué un rôle essentiel dans la stabilité des prix de l’électricité pendant 15 ans, y compris pendant la crise énergétique, même si l’écrêtement en a limité les effets protecteurs. Sa complexité, ses fragilités techniques, et son statut ambivalent ont été autant de faiblesses mises en valeur dans le débat public pour affaiblir sa légitimité. L’abandon de l’ARENH a pour effet d’accroître la place du marché dans la formation du prix, et donc d’accroître les incertitudes économiques pour l’ensemble des acteurs.
L’auteur remercie Ilyas Hanine pour sa relecture.
Thomas Reverdy, Professeur des Universités en sociologie, Grenoble INP – UGA
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.