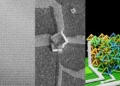L’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques constitue un défi technique et économique complexe. Alors que la demande mondiale d’électricité verte s’accroît, des solutions innovantes émergent pour répondre aux besoins croissants tout en assurant une stabilité accrue des infrastructures énergétiques. Parmi ces initiatives figurent les centrales hybrides, dont le développement massif redessine progressivement le paysage énergétique européen.
En Europe, des installations de grande envergure se multiplient, combinant plusieurs sources d’énergie renouvelable avec des systèmes de stockage sophistiqués. Un projet portugais a été conçu autour d’une installation photovoltaïque de 365 mégawatts (MW), complétée par un parc éolien de 264 MW, un système de stockage par batterie de 168 MW et un électrolyseur de 500 kilowatts (kW) destiné à produire de l’hydrogène vert. Cette combinaison illustre parfaitement la polyvalence offerte par ce type d’infrastructure.
Un autre exemple significatif est visible en Espagne, où une centrale hybride associe énergie solaire photovoltaïque et hydroélectricité. En Bulgarie, une installation similaire voit le jour, intégrant 238 MW de capacité photovoltaïque, 250 MW d’énergie éolienne et un système de stockage de 250 MW. Ces projets démontrent la diversité des configurations possibles pour maximiser leur efficacité opérationnelle.
L’essor exponentiel du photovoltaïque
La progression fulgurante du secteur photovoltaïque a été soulignée par des chiffres marquants. En 2015, la capacité mondiale installée atteignait 200 gigawatts (GW). Huit années plus tard, cette valeur s’est élevée à 2 000 GW, soit une multiplication par dix. L’Agence internationale de l’énergie prévoit qu’en 2030, la capacité photovoltaïque pourrait atteindre 6 000 GW. Ce développement spectaculaire impose une réflexion approfondie sur les modalités d’intégration de cette énergie dans les réseaux existants.
Les systèmes hybrides, qui combinent production solaire et solutions de stockage, deviennent ainsi incontournables. « Leur rôle ne se limite pas à produire de l’électricité« , explique un expert de l’industrie lors de la conférence Intersolar Europe. Il met en lumière l’importance stratégique de telles installations : « Ils participent activement à stabiliser les réseaux et à optimiser leur fonctionnement. »
Des coûts en chute libre
Une baisse drastique des coûts des composants constitue un facteur clé derrière l’essor des centrales hybrides. Les prix des équipements photovoltaïques ont diminué de 85 % au cours des quinze dernières années, tandis que ceux des systèmes de stockage par batterie ont chuté de 90 %. Une étude publiée en juillet 2024 par l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ISE) indique que le coût actualisé de l’électricité (LCOE) pour les fermes solaires allemandes varie entre 4,1 et 6,9 centimes d’euro par kilowattheure (kWh).
Lorsque des installations photovoltaïques sont couplées à des systèmes de stockage, ce coût s’élève entre 6,0 et 10,8 centimes/kWh. À titre de comparaison, l’électricité issue de centrales à charbon brun coûte entre 15,1 et 25,7 centimes/kWh, celle des centrales à charbon dur entre 17,3 et 29,3 centimes/kWh, et celle des centrales nucléaires entre 13,6 et 49,0 centimes/kWh. La différence tarifaire souligne ici l’avantage économique majeur des centrales hybrides.
Un rôle clé pour les batteries
Les batteries jouent un rôle central dans le fonctionnement des centrales hybrides. Elles permettent l’arbitrage énergétique, c’est-à-dire le stockage de l’électricité lorsque les prix sont bas et sa restitution lorsque la demande augmente. De plus, elles assurent des services essentiels à la stabilité des réseaux, augmentant leur résilience face aux fluctuations.
Des systèmes de contrôle avancés ont été développés pour optimiser la rentabilité de ces installations tout en soutenant les réseaux électriques. « Nous assistons à une véritable mutation technologique« , affirme un chercheur spécialisé dans les énergies renouvelables. Cette transformation repose sur l’automatisation et l’intelligence artificielle, qui pilotent désormais les processus complexes de gestion énergétique.
Optimisation des points de raccordement
Les points de raccordement au réseau électrique représentent souvent un goulot d’étranglement pour le déploiement des énergies renouvelables. En combinant production solaire et éolienne, il est possible d’augmenter considérablement l’utilisation de ces infrastructures. Surdimensionner les installations de 250 % permettrait d’atteindre un taux d’utilisation de 53 % pour un point de raccordement donné.
À titre de comparaison, les centrales photovoltaïques isolées affichent un taux moyen de 13 %, tandis que celui des parcs éoliens se situe autour de 33 %. Selon la Fédération allemande des énergies renouvelables, cette approche constitue un levier simple mais efficace pour maximiser les ressources disponibles.
Légende illustration : Que ce soit en Espagne, au Portugal ou en Bulgarie, des centrales électriques hybrides en réseau sont construites dans de nombreux pays européens. ©Solar Promotion GmbH
Source : CP / Solar Promotion GmbH