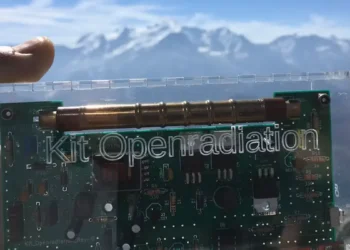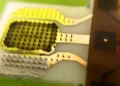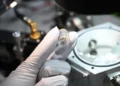Gerald Frankel, The Ohio State University
Aux États-Unis, environ 90 000 tonnes de déchets nucléaires sont stockées sur plus de 100 sites dans 39 États, dans des structures et des conteneurs différents.
Pendant des décennies, le pays a essayé de tout envoyer dans un endroit sûr.
Une loi fédérale de 1987 a désigné Yucca Mountain, dans le Nevada, comme site d’élimination permanente des déchets nucléaires, mais des contestations politiques et juridiques ont entraîné des retards dans la construction. Les travaux sur le site avaient à peine commencé que le Congrès mettait fin au financement du projet en 2011.
Les 94 réacteurs nucléaires actuellement en service dans 54 centrales électriques continuent de produire davantage de déchets radioactifs. L’intérêt du public et des entreprises pour l’énergie nucléaire augmente en raison des préoccupations concernant les émissions des centrales à combustibles fossiles et de la possibilité de nouvelles applications pour les centrales nucléaires à petite échelle afin d’alimenter les centres de données et l’industrie manufacturière. Ce regain d’intérêt confère une nouvelle urgence aux efforts déployés pour trouver un endroit où stocker les déchets.
En mars 2025, la Cour suprême des États-Unis a entendu les arguments relatifs à la recherche d’un lieu de stockage temporaire pour les déchets nucléaires du pays – une décision est attendue pour la fin du mois de juin. Quelle que soit l’issue, la lutte menée depuis des décennies pour trouver un lieu permanent d’élimination des déchets nucléaires se poursuivra probablement pendant de nombreuses années.
Je suis un chercheur spécialisé dans la corrosion ; l’un des axes de mon travail a été le confinement des déchets nucléaires lors de leur stockage temporaire et de leur élimination définitive. Il existe généralement deux formes de déchets radioactifs importants aux États-Unis : les déchets issus de la fabrication d’armes nucléaires pendant la guerre froide et les déchets issus de la production d’électricité dans les centrales nucléaires. Il existe également de petites quantités d’autres déchets radioactifs, tels que ceux associés aux traitements médicaux.

Déchets provenant de la fabrication d’armes
Les restes du traitement chimique des matières radioactives nécessaires à la fabrication des armes nucléaires, souvent appelés « déchets de défense », seront finalement fondus avec le verre, et les matériaux obtenus seront versés dans des conteneurs en acier inoxydable. Ces conteneurs mesurent 10 pieds de haut et 2 pieds de diamètre, et pèsent environ 5 000 livres lorsqu’ils sont remplis.
Pour l’instant, cependant, la majeure partie est stockée dans des réservoirs souterrains en acier, principalement à Hanford, dans l’État de Washington, et à Savannah River, en Caroline du Sud, des sites clés pour le développement des armes nucléaires aux États-Unis. À Savannah River, une partie des déchets a déjà été traitée avec du verre, mais une grande partie reste non traitée.
Sur ces deux sites, une partie des déchets radioactifs s’est déjà infiltrée dans le sol sous les réservoirs, mais les autorités ont déclaré qu’il n’y avait pas de danger pour la santé humaine. La plupart des efforts déployés actuellement pour contenir les déchets visent à protéger les cuves contre la corrosion et les fissures afin d’éviter de nouvelles fuites.
Déchets provenant de la production d’électricité
La grande majorité des déchets nucléaires aux États-Unis est constituée de combustible nucléaire usé provenant de centrales nucléaires commerciales.
Avant d’être utilisé, le combustible nucléaire se présente sous la forme de pastilles d’oxyde d’uranium qui sont scellées dans des tubes de zirconium, eux-mêmes regroupés en grappes. Ces faisceaux de crayons de combustible mesurent de 12 à 16 pieds de long et de 5 à 8 pouces de diamètre. Dans un réacteur nucléaire, les réactions de fission alimentées par l’uranium contenu dans ces crayons dégagent de la chaleur qui est utilisée pour créer de l’eau chaude ou de la vapeur afin d’actionner des turbines et de produire de l’électricité.
Au bout de trois à cinq ans, les réactions de fission dans une grappe de combustible donnée ralentissent considérablement, même si la matière reste hautement radioactive. Les grappes de combustible usé sont retirées du réacteur et déplacées sur le site de la centrale, où elles sont placées dans une immense piscine d’eau pour les refroidir.
Après environ cinq ans, les grappes de combustible sont retirées, séchées et scellées dans des conteneurs en acier inoxydable soudés. Ces conteneurs sont encore radioactifs et thermiquement chauds. Ils sont donc stockés à l’extérieur dans des voûtes en béton qui reposent sur des socles en béton, également sur le terrain de la centrale. Ces voûtes sont équipées d’évents qui permettent à l’air de circuler à travers les silos pour continuer à les refroidir.
En décembre 2024, il y avait plus de 315 000 grappes de barres de combustible nucléaire usé aux États-Unis et plus de 3 800 conteneurs de stockage à sec dans des voûtes en béton au-dessus du sol, situés dans des centrales électriques actuelles et anciennes dans tout le pays.
Même les réacteurs qui ont été déclassés et démolis conservent des voûtes en béton dans lesquelles sont stockés les déchets radioactifs, qui doivent être sécurisés et entretenus par la compagnie d’électricité propriétaire de la centrale nucléaire.

La menace de l’eau
L’une des menaces qui pèsent sur ces méthodes de stockage est la corrosion.
Parce qu’elles ont besoin d’eau pour transférer l’énergie nucléaire en électricité et pour refroidir le réacteur, les centrales nucléaires sont toujours situées à proximité de sources d’eau.
Aux États-Unis, neuf d’entre eux se trouvent à moins de trois kilomètres de l’océan, ce qui constitue une menace particulière pour les conteneurs de déchets. Lorsque les vagues se brisent sur le littoral, l’eau salée est projetée dans l’air sous forme de particules. Lorsque ces particules de sel et d’eau se déposent sur les surfaces métalliques, elles peuvent provoquer de la corrosion, ce qui explique pourquoi il est courant de voir des structures fortement corrodées près de l’océan.
Dans les sites de stockage de déchets nucléaires situés à proximité de l’océan, les embruns salés peuvent se déposer sur les conteneurs en acier. En règle générale, l’acier inoxydable résiste à la corrosion, comme en témoignent les casseroles et poêles brillantes qui ornent les cuisines de nombreux Américains. Mais dans certaines circonstances, des piqûres et des fissures localisées peuvent se former sur les surfaces en acier inoxydable.
Ces dernières années, le ministère américain de l’énergie a financé des recherches, dont la mienne, sur les dangers potentiels de ce type de corrosion. Les conclusions générales sont que les conteneurs en acier inoxydable pourraient s’abîmer ou se fissurer s’ils étaient stockés près d’un bord de mer. Mais une fuite radioactive nécessiterait non seulement la corrosion du conteneur, mais aussi celle des barres de zirconium et du combustible qu’elles contiennent. Il est donc peu probable que ce type de corrosion entraîne un rejet de radioactivité.
Un long chemin à parcourir
Une solution plus permanente ne sera probablement pas trouvée avant des années, voire des décennies.
Non seulement le site à long terme doit être géologiquement adapté au stockage des déchets nucléaires pendant des milliers d’années, mais il doit également être politiquement acceptable pour le peuple américain. En outre, le transport des déchets, dans leurs conteneurs, par la route ou le rail, depuis les réacteurs à travers le pays jusqu’au site permanent, quel qu’il soit, posera de nombreux problèmes.
Peut-être y aura-t-il un site temporaire dont l’emplacement conviendra à la Cour suprême. Mais en attendant, les déchets resteront là où ils sont.
Légende illustration : Un employé de Southern California Edison mesure les radiations à la centrale nucléaire de San Onofre le 10 mars 2020. Paul Bersebach/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images
Gerald Frankel, Professeur émérite de science et d’ingénierie des matériaux, The Ohio State University
Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original