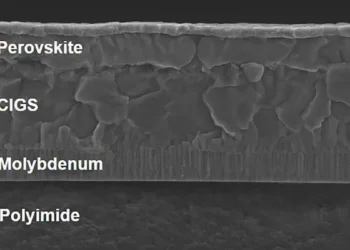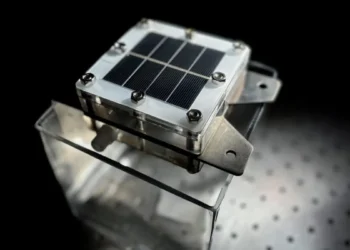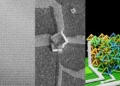Au cœur du vignoble, à Charentay dans le Rhône, une installation transforme désormais les résidus locaux en gaz renouvelable injecté dans le réseau et en fertilisant naturel pour les terres agricoles. Le projet Bio Énergies Beaujolaises (BEB), porté par une structure public-privé inédite pour la méthanisation en France, incarne une application pragmatique de l’économie circulaire à l’échelle territoriale.
Sur quatre hectares de la zone d’activités Lybertec, non loin des cuves vinicoles, d’autres types de fermenteurs sont entrés en action. Depuis mars 2025, l’unité de méthanisation Bio Énergies Beaujolaises digère quotidiennement 85 tonnes de matières organiques. Loin d’être anecdotique, cette mise en service est le fruit d’une gestation de dix ans, une décennie durant laquelle élus locaux, agriculteurs et industriels ont cherché à tisser une solution locale pour la gestion des déchets et la production d’énergie verte.
Une collecte raisonnée, à l’échelle du territoire
La force du modèle beaujolais réside dans sa matière première, exclusivement sourcée dans un périmètre restreint pour limiter les transports et renforcer la cohérence territoriale. Point de cultures énergétiques dédiées ici, une pratique parfois critiquée dans d’autres projets de méthanisation. L’usine BEB valorise ce que le territoire produit comme résidus : les boues issues des stations d’épuration gérées par le CITEAU (Centre Intercommunal de Traitement de l’Eau) de Belleville-en-Beaujolais et de l’agglomération voisine de Villefranche-sur-Saône constituent une part significative des intrants.
S’y ajoutent des coproduits de l’industrie agroalimentaire locale – lactosérum des fromageries, marcs de raisin issus de la distillation après les vendanges – ainsi que des déchets agricoles comme les effluents d’élevage ou les résidus végétaux. Au total, quelque 35 000 tonnes de matières organiques par an trouvent ici une seconde vie, évitant l’enfouissement ou un traitement moins vertueux. Cette diversité d’intrants a nécessité la conception de deux lignes de traitement distinctes mais complémentaires au sein de l’unité, optimisant le processus biologique.
Du déchet au gaz renouvelable
Au cœur de l’installation, dans de larges digesteurs maintenus sans oxygène, des bactéries réalisent leur œuvre métabolique. Elles décomposent la matière organique, produisant d’une part un biogaz brut, mélange de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2), et d’autre part, un résidu stabilisé appelé digestat.
Le biogaz subit ensuite une étape d’épuration pour en retirer le CO2 et d’autres impuretés. Le résultat est le biométhane, un gaz présentant les mêmes caractéristiques que le gaz naturel fossile, mais d’origine renouvelable. L’unité BEB est dimensionnée pour injecter jusqu’à 350 normo mètres cubes (Nm³) de ce biométhane par heure directement dans le réseau de distribution de GRDF voisin. La production annuelle attendue, environ 33 gigawattheures (GWh), correspond à la consommation énergétique de 4 000 foyers aujourd’hui, avec un potentiel estimé à terme pour 8 000 foyers. Une contribution tangible à l’approvisionnement énergétique local.
Le retour à la terre : boucler la boucle
L’autre produit majeur du processus est le digestat. Environ 35 000 mètres cubes de cette matière riche en éléments nutritifs (azote, phosphore, potassium) sont générés chaque année. Loin d’être un déchet ultime, il représente une ressource précieuse pour l’agriculture locale. Épandu sur les parcelles des agriculteurs partenaires du projet, il agit comme un amendement organique, améliorant la structure des sols et fournissant les nutriments nécessaires aux cultures.
Cette valorisation agricole intégrale du digestat permet de substituer l’usage d’engrais chimiques de synthèse, dont la production est énergivore et l’utilisation parfois source de pollution. Un suivi agronomique rigoureux est d’ailleurs mis en place pour optimiser son utilisation et garantir son innocuité, avec en ligne de mire une possible labellisation attestant de sa qualité. Le cycle est ainsi bouclé : les nutriments contenus dans les déchets retournent nourrir la terre qui les a produits.
Un montage public-privé au service du circuit court
Pour orchestrer ce projet d’un coût total de 12 millions d’euros – soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Europe via le FEDER, l’ADEME et l’Agence de l’Eau – le territoire a opté pour une structure juridique spécifique : la Société d’Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP). C’est une première en France pour une unité de méthanisation.
Cette SEMOP, baptisée Bio Énergies Beaujolaises, associe le CITEAU, représentant la puissance publique et garant de l’intérêt général, et la société Agriopale Services, apportant son expertise technique et opérationnelle. Ce montage permet à la collectivité de conserver une maîtrise stratégique du projet tout en bénéficiant de l’agilité du secteur privé.
Frédéric Pronchéry, président de la SEMOP et élu local, souligne que ce projet est « l’aboutissement d’une volonté forte : produire de l’énergie renouvelable ici, à partir de nos ressources, avec une gouvernance publique exemplaire« .
Au-delà du gaz, une dynamique territoriale
L’intégration de l’unité dans son environnement a fait l’objet d’attentions particulières, avec des cuves partiellement enterrées pour limiter l’impact visuel, un traitement poussé de l’air pour maîtriser les odeurs et une végétalisation du site. Les ambitions ne s’arrêtent pas là. Les porteurs du projet explorent déjà des pistes pour aller plus loin : la capture et la valorisation du CO₂ séparé lors de l’épuration du biogaz, ou encore le développement de technologies de méthanation pour produire davantage de méthane.
L’objectif affiché est de faire du site un embryon de « cluster territorial du biogaz« , fédérant acteurs de la recherche, de la formation et des filières agricoles autour de cette thématique. Bio Énergies Beaujolaises n’est pas seulement une usine de traitement et de production ; elle se veut une démonstration qu’une gestion locale et circulaire des ressources est possible, créant de la valeur économique et environnementale sur son territoire. Une illustration concrète de la manière dont les déchets des uns peuvent devenir l’énergie et les nutriments des autres, au bénéfice de la collectivité.
Source : CCSB – Communauté de Communes Saône-Beaujolais