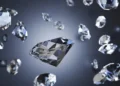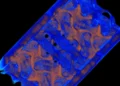Pour que la Suisse atteigne son objectif de zéro climatique net, elle doit non seulement réduire ses émissions de CO2, mais aussi trouver un moyen de stocker ce gaz à effet de serre de manière permanente. Des chercheurs de l’ETH Zurich ont étudié si, et dans quelles conditions, le CO2 pouvait être stocké sous terre en Suisse.
Pour atteindre son objectif de zéro émission de gaz à effet de serre d’ici 2050, la Suisse doit poursuivre la transition énergétique, que ce soit dans le domaine de l’électricité, du chauffage ou de la mobilité. Le stockage permanent du CO2 est un autre défi important. La Suisse doit notamment trouver une solution permanente pour les émissions qu’il est difficile ou impossible d’éviter, comme celles produites par les incinérateurs de déchets. Des chercheurs de l’ETH Zurich ont mené la première étude jamais réalisée pour déterminer si le CO2 peut être stocké durablement dans le sous-sol suisse sous forme de roches carbonatées et quels critères devraient être remplis pour que cela soit possible. Ils présentent leurs résultats dans une étude publiée récemment dans la Revue suisse des géosciences.
Comment la roche peut-elle être utilisée pour stocker le CO2 ?
Dans un premier temps, les chercheurs veulent savoir s’il existe en Suisse des zones où le CO2 peut être stocké durablement dans le sous-sol rocheux. Le stockage permanent du CO2 dans le sous-sol exige que la roche soit riche en calcium, en magnésium et en fer et qu’elle contienne le moins possible de dioxyde de silicium. Les candidats potentiels sont le basalte, la péridotite et la serpentinite. Pour une capacité de stockage idéale, la roche du sous-sol doit également avoir un certain volume et se situer à une profondeur d’au moins 350 mètres afin que la pression soit suffisamment élevée pour maintenir le CO2 dans l’eau. Une température optimale comprise entre 90 et 185 degrés Celsius, ainsi que l’âge, l’état d’altération, la porosité et la perméabilité de la roche jouent également un rôle important.
« Ce sont là quelques-uns des critères qui doivent être remplis avant qu’une zone puisse être considérée comme un réservoir », explique Adrian Martin, dont le mémoire de maîtrise constitue la base de cette étude. Il a depuis approfondi ses travaux au Centre des sciences de l’énergie de l’ETH Zurich sous la direction de Marco Mazzotti, professeur émérite de génie des procédés.
Pour stocker le CO2 dans le sous-sol, on le dissout dans l’eau et on le pompe sous forme d’acide carbonique. L’eau utilisée est d’abord acide, c’est-à-dire qu’elle a un pH faible. Elle pénètre et dissout la roche poreuse, libérant des ions de fer, de magnésium et de calcium. Le pH de l’eau injectée augmente alors et, à un certain moment, une réaction inverse se produit : le CO2 se combine au calcium et au magnésium pour former une roche carbonatée blanche, par exemple du calcaire. « Ce processus est appelé minéralisation in situ », ajoute M. Martin.
Un potentiel reconnu, mais une faisabilité discutable
Thanushika Gunatilake, ancienne post-doctorante de Stefan Wiemer, professeur au département des sciences de la terre et des planètes et chef du service sismologique suisse, a également participé à l’étude. Elle est aujourd’hui professeur assistant à la Vrije Universiteit Amsterdam et souligne que cette recherche à l’échelle nationale de types de roches adéquates est la première du genre en Suisse. Martin n’a pas seulement analysé de nombreuses études scientifiques, il a également examiné les cartes géologiques région par région et a identifié les endroits qui répondent aux critères et qui pourraient donc convenir à la minéralisation in situ du CO2. Il s’agit notamment de la zone de Zermatt-Saas et de la nappe de Tsaté en Valais, ainsi que de la zone d’Arosa dans les Grisons.
Les zones identifiées par Martin ne sont actuellement pas adaptées au stockage souterrain permanent du CO2. « Bien que nous disposions en Suisse de types de roches appropriés, nous sommes confrontés à des défis techniques majeurs », indique M. Martin. La structure géologique est très complexe en raison des strates rocheuses fortement plissées et des failles tectoniques. Dans la nappe de Tsaté, en Valais, les couches de roches appropriées dans des zones telles que celle située entre la Gouille et le Mont des Ritses peuvent avoir une épaisseur de plus de 500 mètres, alors qu’aux Diablons, l’épaisseur n’est que d’environ 150 mètres.
D’autres facteurs viennent s’ajouter au problème : les roches de la zone de Zermatt-Saas, par exemple, ont été transformées dans le passé par des pressions et des températures élevées et contiennent déjà de nombreux minéraux carbonatés, ce qui indique que l’absorption naturelle de CO2 (c’est-à-dire la minéralisation antérieure) s’est déjà produite. En outre, les roches de Zermatt sont très serrées les unes contre les autres dans le sous-sol et contiennent peu de cavités ouvertes ou de fissures dans lesquelles le CO2 pourrait pénétrer.
En outre, le volume d’eau nécessaire à la minéralisation in situ est énorme : près de 25 tonnes d’eau seraient nécessaires pour stocker une tonne de CO2. Adrian Martin ajoute : « En outre, il existe des obstacles économiques et sociétaux : Qui supportera les coûts ? Comment surmonter le scepticisme des résidents locaux qui s’inquiètent de la pollution de l’eau, par exemple ? Quelles seraient les réglementations légales ? »
Méthodes alternatives de stockage du CO2
Les chercheurs concluent que le stockage permanent du CO2 par minéralisation in situ en Suisse n’est pas réalisable à court terme et semble inadapté à long terme. Ils recommandent donc d’étudier d’autres méthodes de stockage. Thanushika Gunatilake a récemment publié une autre étude, portant cette fois sur le stockage du CO2 dans les aquifères salins. Pour ce projet, les chercheurs ont analysé, à l’aide de simulations numériques, des données provenant de la région de Triemli à Zurich. Ils ont réussi à injecter du CO2 dans l’unité géologique, le Muschelkalk inférieur, à une profondeur de plus de 2 000 mètres sans eau. « Cette méthode de stockage du CO2 est prometteuse », souligne t-il.
Il existe également des projets qui démontrent avec succès le stockage permanent du CO2 sous terre. « Un exemple est le projet DemoUpCARMA, où le CO2 de la Suisse a été transporté en Islande où il est maintenant stocké sous terre sous forme de roche carbonatée », déclare Martin.
Il est important de sensibiliser le public à cette question et de dissiper les mythes et les rumeurs. « Beaucoup de gens pensent que nous créons une bulle souterraine et qu’elle pourrait même exploser à un moment ou à un autre », explique M. Martin. « Mais le risque que représente le stockage souterrain du CO2 pour le public est minime et les méthodes sont scientifiquement prouvées. »
Légende illustration : Le CO2 est dissous dans l’eau et pompé à 350 mètres sous terre où il est stocké en permanence. (Image : adaptée de : Campbell, J. S. et. al. (2022). Technologies géochimiques d’émissions négatives : Part I. Review, Frontiers in Climate 4).
Martin A, Becattini V, Marieni C, Kolbeinsdóttir S, Mazzotti M, Gunatilake T. Potential and challenges of underground CO2 storage via in-situ mineralization in Switzerland. Swiss J Geosci 118, 1 (2025). doi: 10.1186/s00015-024-00473-4
Source : ETHZ – – Traduction enerzine.com