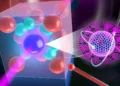Le 20 février 2024, l’Assemblée nationale adoptait à une large majorité la proposition de loi visant à interdire l’usage des PFAS, ces substances per- et polyfluoroalkylées qualifiées de « polluants éternels ». Une décision saluée par les ONG écologistes, applaudie par une partie des médias, et portée comme une victoire politique par le député écologiste Nicolas Thierry. Pourtant, derrière les slogans sanitaires et l’urgence environnementale brandis en étendard, se profile une autre réalité, plus rude, plus concrète : celle d’une industrie française fragilisée et d’un effort de réindustrialisation national contredit dans ses fondements.
Une loi sanitaire… mais à quel prix économique ?
Les PFAS sont présents dans d’innombrables applications industrielles : textiles imperméables, batteries lithium, prothèses médicales, semi-conducteurs, joints, lubrifiants pour éoliennes, et même dans 40 % des nouvelles molécules pharmaceutiques selon les chercheurs du CNRS. Leur usage s’explique par des propriétés physico-chimiques uniques (résistance à la chaleur, à l’eau, aux produits chimiques). Tous les PFAS ne sont pas toxiques, mais la loi française fait le choix de l’interdiction globale, sans différenciation de dangerosité.
Dès 2026, les cosmétiques, les vêtements, les chaussures, les produits de fart pour ski contenant des PFAS seront interdits. À l’horizon 2030, tous les textiles seront concernés. Problème : plusieurs filières clés de l’industrie française reposent sur ces substances, notamment dans les matériaux de pointe. Les alternatives n’existent pas toujours, ou ne sont pas matures. Et lorsque des substituts sont envisageables, leur coût et leur performance restent problématiques. L’entreprise Daikin Chemical France a déjà annoncé une fermeture de site, première victime visible d’une politique trop rapide.
Un contre-sens historique face à l’agenda de réindustrialisation
Ce timing pose question, car la France est engagée depuis plusieurs années dans une stratégie assumée de réindustrialisation. Emmanuel Macron a fait de ce chantier un pilier de sa politique économique, en réponse à des décennies de désindustrialisation massive. Le plan « France 2030 », lancé en octobre 2021, prévoit 54 milliards d’euros pour soutenir les industries d’avenir. En mars 2023, le président annonçait fièrement 90 000 créations d’emplois industriels depuis 2017 et 300 usines ouvertes ou relocalisées.
Dès lors, comment justifier une loi qui, au nom d’un principe de précaution sans nuance, risque de compromettre cette dynamique ? L’industrie du textile, déjà fragilisée, alerte : les stocks sont déjà constitués pour les deux années à venir. L’interdiction brutale pourrait rendre ces produits invendables et forcer certaines PME à délocaliser leurs unités… en Belgique ou en Espagne, où la réglementation européenne n’entrera en vigueur qu’en 2028.
Olivier Ducatillon, président de l’Union des industries textiles, dénonce une logique ubuesque : « Si vous avez plusieurs centaines de milliers d’euros de stock en France, et qu’on vous dit du jour au lendemain ‘votre stock vaut zéro’, votre entreprise est morte. »
Une législation sous influence ?
Les soutiens de la loi évoquent un « consensus scientifique écrasant », selon les termes de la militante Camille Étienne. Mais plusieurs chercheurs, comme Bruno Améduri, chimiste au CNRS, dénoncent une confusion délibérée entre les PFAS toxiques de faible masse (comme le PFOA, déjà interdit en Europe depuis 2020) et ceux de masse élevée, inertes, non solubles et non bioassimilables, tels que le PTFE utilisé dans les poêles Téfal ou les dispositifs médicaux.
Bruno Améduri, contacté par France 2, n’a jamais vu son interview diffusée. Il déplore, dans une vidéo postée par François de Rugy et Laurent Lesage sur Youtube, n’avoir été ni entendu ni consulté par les députés à l’origine de la loi. À ses yeux, interdire indistinctement tous les PFAS, c’est comme bannir tous les plastiques parce que certains sont nocifs.
Le texte voté n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune étude d’impact économique. Une exception permise pour les propositions de loi parlementaires, mais problématique lorsqu’on mesure les conséquences potentielles sur des milliers d’emplois, des filières entières, et même la souveraineté technologique du pays.
PFAS : Santé publique ou dogmatisme écologique ?
Oui, les PFAS doivent être encadrés. Oui, leur toxicité doit être étudiée rigoureusement. Oui, des efforts doivent être faits pour limiter leur usage là où des alternatives existent. Mais non, toutes les molécules classées PFAS ne sont pas équivalentes. Et non, l’émotion médiatique ne doit pas se substituer au travail législatif rationnel, surtout lorsque l’avenir de pans entiers de l’industrie française est en jeu.
En voulant ériger la France en pionnière de la régulation PFAS, le législateur risque de provoquer une désindustrialisation accélérée, doublée d’un effet boomerang écologique : les mêmes produits seront importés, souvent depuis des pays où les normes sont bien moindres. Ce qui aura finalement un effet paradoxal : la France aura interdit les PFAS… et se retrouvera avec les plus dangereux d’entre eux sur son sol.
Source ( Article partenaire )