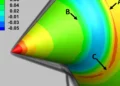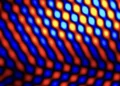Une équipe de scientifiques de Singapour (NTU Singapore) a mis au point des « tuiles de champignons » qui pourraient un jour contribuer à réduire la chaleur dans les bâtiments sans consommer d’énergie.
Ces carreaux muraux sont fabriqués à partir d’un nouveau biomatériau combinant le réseau racinaire des champignons – appelé mycélium – et des déchets organiques. Des recherches antérieures[1] ont montré que les composites à base de mycélium sont plus efficaces sur le plan énergétique que les matériaux d’isolation conventionnels tels que la vermiculite expansée et les agrégats légers d’argile expansée.
S’appuyant sur cette propriété isolante éprouvée, l’équipe de la NTU de Singapour a travaillé avec l’entreprise locale de conception écologique et biomimétique bioSEA pour ajouter une texture bosselée et ridée à la tuile, imitant la capacité de l’éléphant à réguler la chaleur à partir de sa peau. Les éléphants n’ont pas de glandes sudoripares et comptent sur les rides et les crevasses de leur peau pour réguler la chaleur.
Lors d’expériences en laboratoire, les scientifiques ont constaté que la vitesse de refroidissement de leur tuile de mycélium inspirée de la peau d’éléphant était supérieure de 25 % à celle d’une tuile de mycélium entièrement plate, et que la vitesse de chauffage était inférieure de 2 %. Ils ont également constaté que l’effet de refroidissement de la tuile inspirée de la peau d’éléphant s’améliorait encore de 70 % dans des conditions de pluie simulée, ce qui la rend adaptée aux climats tropicaux.
Le secteur de la construction représente près de 40 % de toutes les émissions liées à l’énergie dans le monde, d’où l’importance de la recherche de matériaux d’isolation respectueux de l’environnement. Hortense Le Ferrand, professeur associé à la NTU, qui a dirigé l’étude, a déclaré que les composites à base de mycélium pourraient constituer une alternative prometteuse.
Le professeur associé Le Ferrand, qui occupe un poste conjoint dans les écoles d’ingénierie mécanique et aérospatiale (MAE) et de science et d’ingénierie des matériaux (MSE) de la NTU, a déclaré : « Les matériaux d’isolation sont de plus en plus intégrés dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation : « Les matériaux d’isolation sont de plus en plus souvent intégrés dans les murs des bâtiments pour améliorer l’efficacité énergétique, mais ils sont pour la plupart synthétiques et ont des conséquences sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie. Le composite lié au mycélium est un matériau biodégradable très poreux, ce qui en fait un bon isolant. En fait, sa conductivité thermique est comparable, voire supérieure, à celle de certains matériaux isolants synthétiques utilisés aujourd’hui dans les bâtiments. »
« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec bioSEA pour intégrer des principes de conception naturels susceptibles d’optimiser ses performances en tant qu’isolant de bâtiment. Le résultat est une preuve de concept prometteuse qui nous rapproche de solutions de refroidissement passif efficaces, durables et moins coûteuses dans des conditions chaudes et humides. »
Le Dr Anuj Jain, directeur fondateur de bioSEA, a expliqué l’inspiration derrière l’innovation liée aux éléphants : « Les éléphants sont des animaux de grande taille qui vivent dans des climats tropicaux chauds et parfois humides. Pour résister à la chaleur, les éléphants ont évolué en développant une peau fortement ridée qui augmente la rétention d’eau et refroidit l’animal par évaporation. Nous nous sommes inspirés de la façon dont un éléphant pouvait se refroidir par temps chaud sans glandes sudoripares, et nous avons essayé de voir comment nous pouvions reproduire les mêmes mécanismes de refroidissement, à savoir l’ombrage, l’emprisonnement de l’air frais et l’augmentation de la surface d’évaporation de l’eau ».
Cette étude, publiée dans la revue Energy & Buildings en février, s’appuie sur les travaux du professeur associé Le Ferrand concernant les utilisations possibles des composites à base de mycélium, notamment pour des matériaux de construction plus écologiques.
Transformer les champignons en matériaux fonctionnels
Les composites à base de mycélium sont créés en cultivant des champignons sur des matières organiques telles que la sciure de bois ou les déchets agricoles. Au fur et à mesure que le champignon se développe, il lie la matière organique en un composite solide et poreux.
Pour cette étude, les scientifiques de la NTU ont utilisé le mycélium du pleurote (Pleurotus ostreatus) – un champignon très répandu – et des copeaux de bambou collectés dans un magasin de meubles.
Ces deux composants ont été mélangés à de l’avoine et à de l’eau, puis emballés dans un moule hexagonal dont la texture, inspirée de la peau d’éléphant, a été conçue par bioSEA à l’aide d’une modélisation informatique et d’algorithmes permettant de sélectionner le modèle optimal.
Les tuiles de mycélium ont été laissées dans l’obscurité pendant deux semaines, puis retirées du moule hexagonal et laissées dans les mêmes conditions pendant deux semaines supplémentaires.
Enfin, les tuiles ont été séchées dans un four à 48°C pendant trois jours. Cette dernière étape permet d’éliminer l’humidité restante et d’empêcher toute nouvelle croissance mycélienne.
La texture inspirée de la peau d’éléphant améliore la régulation thermique
Des recherches antérieures ont montré que les composites liés au mycélium ont une conductivité thermique comparable à celle des matériaux d’isolation conventionnels pour le bâtiment, comme la laine de verre et le polystyrène extrudé.
Pour évaluer l’influence d’une texture inspirée de la peau d’éléphant sur la régulation thermique des carreaux de mycélium, les scientifiques ont chauffé des carreaux de mycélium sur une plaque chauffante à 100 °C pendant 15 minutes et ont suivi les changements de température à l’aide d’une caméra infrarouge.
Ils ont constaté que la tuile inspirée de la peau d’éléphant absorbait la chaleur plus lentement. Lorsque sa surface texturée et bosselée faisait face à la source de chaleur, sa température augmentait de 5,01 °C par minute, contre 5,85 °C par minute lorsque sa surface plane était exposée à la chaleur. À titre de contrôle, les scientifiques ont également chauffé une tuile plate en mycélium et ont constaté que sa température augmentait de 5,01 °C par minute, contre 5,85 °C par minute lorsque sa surface était plate.
Pour mesurer l’efficacité du refroidissement de la tuile, les scientifiques ont chauffé une face à 100 °C pendant 15 minutes, puis l’ont exposée aux conditions ambiantes (22 °C, 80 % d’humidité) et ont mesuré les changements de température sur la face opposée de la tuile.

La tuile inspirée de la peau d’éléphant s’est refroidie le plus rapidement lorsqu’elle était chauffée du côté plat, perdant 4,26 °C par minute. Lorsqu’elle est chauffée du côté texturé, sa face plane perd 3,12°C par minute. La tuile de contrôle entièrement plate a perdu 3,56°C par minute.
Sur la base de ces résultats, les scientifiques ont recommandé d’installer les tuiles avec la face plate collée à la façade du bâtiment et la surface texturée exposée à la chaleur extérieure pour une performance thermique optimale (voir l’image dans les Notes au rédacteur pour savoir comment les tuiles pourraient être utilisées).
Les tuiles sont plus performantes par temps humide
Pour simuler l’effet de la pluie sur les tuiles, les scientifiques ont chauffé les tuiles comme décrit précédemment. Tout en les laissant refroidir, ils ont pulvérisé de l’eau sur les tuiles à intervalles d’une minute sur une période de 15 minutes.
Lorsqu’elle a été aspergée sur sa face bosselée, la tuile inspirée de la peau d’éléphant a perdu 7,27 °C par minute, soit une amélioration de 70 % par rapport à sa performance dans des conditions sèches.
Les scientifiques ont attribué cet effet à la nature hydrophobe du composite lié au mycélium. « La peau fongique qui se développe à la surface de la tuile repousse l’eau, ce qui permet aux gouttes de rester à la surface plutôt que de rouler immédiatement. Cela favorise le refroidissement par évaporation et augmente la vitesse de refroidissement », explique Eugene Soh, chercheur à la NTU et premier auteur de l’étude.
S’appuyant sur cette démonstration de faisabilité, les scientifiques étudient à présent les moyens d’améliorer les tuiles pour une utilisation dans le monde réel, par exemple en augmentant leur stabilité mécanique et leur durabilité ou en utilisant différentes souches de mycélium.
Ils travaillent également avec la start-up locale Mykílio pour augmenter la taille des tuiles de mycélium et effectuer des tests en extérieur sur des façades de bâtiments.
Le temps nécessaire à la culture des tuiles de mycélium est l’un des défis qu’ils prévoient de relever pour augmenter la production des tuiles. Bien qu’il nécessite des ressources énergétiques minimales, le processus prend trois à quatre semaines.
Les scientifiques s’attendent également à une grande inertie face à l’utilisation des tuiles de mycélium comme matériau de construction alternatif, en raison de l’infrastructure bien établie pour la production, le stockage et le transport des matériaux isolants courants.
Le professeur associé Le Ferrand a conclu : « Nous avons mis au point un matériau écologique prometteur : « Nous avons développé une alternative écologique prometteuse qui transforme les déchets en une ressource précieuse tout en repensant les matériaux de gestion thermique conventionnels. Cela ouvre la voie à d’autres conceptions inspirées de la peau d’éléphant et à l’utilisation de différentes souches de mycélium pour surmonter les difficultés liées à l’utilisation des tuiles de mycélium comme matériau de construction alternatif. »
Article : « Thermal insulation and energy performance’s assessment of a mycelium-based composite wall for sustainable buildings. Case Studies in Construction Materials » – DOI : 10.1016/j.enbuild.2024.115187
Légende illustration : Les scientifiques de la NTU, en collaboration avec la société locale de conception écologique et de biomimétisme bioSEA, ont mis au point des « tuiles de champignons » qui pourraient contribuer à refroidir les bâtiments sans consommer d’énergie. De gauche à droite : Hortense Le Ferrand, professeur associé à la NTU ; Anuj Jain, de bioSEA ; Teo Jia Heng, chercheur à la NTU ; Eugene Soh, chercheur à la NTU.